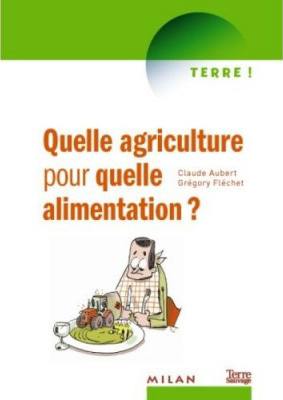TERRE!, ÉDITIONS MILAN, 2007
Championne du monde de l’utilisation des pesticides et autres intrants phytosanitaire, l’agriculture française est dans une situation paradoxale. Dopée par les aides de toute sorte, elle conquiert des marchés à l’exportation et a fait de la France le grenier de l’Europe. Mais la facture est lourde : cours d’eau asphyxiés, nappes phréatiques endommagées, biodiversité en chute libre. Et surtout, effets dramatiques sur la santé des consommateurs. Claude Aubert trace la voie d’une alternative à cette agriculture aussi prospère que mortifère, la voie d’un atterrissage en douceur, la voie d’un modèle agricole capable de concilier santé humaine, préservation de la nature… et efficacité économique.
Alimentation, santé et environnement -Problématique p 7-8-
Assurer la sécurité alimentaire de sa population ne devrait-il pas être la vocation de toute agriculture nationale ? Ce défi, la France l’a relevé dès le milieu du xxe siècle, en généralisant l’agriculture productiviste. Mais une nation qui assure sa sécurité alimentaire ne garantit pas pour autant à sa population une alimentation et un environnement de qualité… Notre pays est toujours aussi fier de son agriculture, techniquement très évoluée. Une agriculture dont les rendements exceptionnels ont permis à la France d’acquérir le titre honorifique de « grenier de l’Europe ». Mais après cinquante ans de pratiques intensives, que reste-t-il de cette grande épopée agricole ? Des nappes phréatiques polluées durablement par les fertilisants agricoles ; un appauvrissement des terres cultivables, conséquence directe de la monoculture céréalière ; des traitements phytosanitaires qui disséminent aux quatre vents substances cancérigènes et mutagènes, et une surabondance de denrées alimentaires nous contraignant à exporter à perte les excédents agricoles. Loin d’être exhaustive, cette énumération illustre néanmoins l’incapacité de l’agriculture dite « conventionnelle » à pouvoir nourrir la population, tout en respectant sa santé et son environnement. Un aveu d’impuissance que font pour l’instant mine d’ignorer nos hommes politiques. Au lieu de s’attaquer à une révision profonde d’un système agricole malade de ses excès, la France se tourne peu à peu vers les biotechnologies, espérant peut-être y trouver le remède aux dégâts causés par l’agriculture intensive. Ainsi, depuis la levée du moratoire européen sur l’interdiction des cultures OGM, les plantes transgéniques reviennent discrètement sur le devant de la scène. Désavouées par 80 % de la population, c’est en catimini et au mépris de la législation communautaire qu’elles s’installent désormais dans le paysage agricole français. Face aux poids lourds de l’agrobusiness, d’autres systèmes agricoles comme le Réseau agriculture durable (RAD) ou l’agriculture intégrée proposent déjà une alternative concrète au modèle conventionnel. Toutefois, la seule option à pouvoir être qualifiée de « durable » reste sans nul doute l’agriculture biologique. Moins gourmande en énergie, respectueuse de l’environnement et de notre santé, cette dernière se révèle totalement en phase avec les attentes de la société actuelle. D’ailleurs, les consommateurs ne s’y trompent pas, près d’un Français sur deux se laissant désormais tenter de temps à autre par les produits bio. Malgré cet engouement pour une alimentation plus saine, il est pourtant légitime de se demander pourquoi l’agriculture biologique française ne représente pas plus de 2 % de la surface agricole totale. Avant tout parce que la volonté politique est encore aux abonnés absents : pris entre le marteau de l’électorat agricole et l’enclume des puissantes firmes agro-industrielles, nos décideurs préfèrent encore cultiver le statu quo. Mais l’inaction politique ne suffit pas à expliquer la difficile progression de l’agriculture biologique. Dans le monde paysan, se convertir au bio est toujours perçu – parfois d’ailleurs à juste titre – comme un véritable parcours du combattant. Un chemin de croix que refusent encore d’affronter la plupart des exploitants agricoles.
En définitive, l’avenir de l’agriculture ne dépendrait-il pas surtout de nos propres choix alimentaires ? Car, s’il en va de la responsabilité de chaque citoyen d’imposer ses desiderata aux filières de l’agroalimentaire, les produits issus de l’agriculture biologique souffrent encore malheureusement de préjugés tenaces, les confinant le plus souvent au panier du consommateur averti. Jugés trop cher, d’aspect pas toujours très engageant, peu disponibles en grande surface, les produits bio sont loin d’être plébiscités par l’ensemble de la population. Pourtant, se nourrir bio demeure à la portée de chacun d’entre nous, au prix, bien sûr, de quelques concessions. Et le label AB offre au consommateur l’assurance de manger des produits sains, dont l’élaboration ne dégrade pas l’environnement, quand elle ne contribue pas à l’améliorer. Mais avant de voir cette agriculture durable s’inviter dans l’assiette de tous les Français, il faut d’abord franchir un cap important : celui de la remise en question de nos habitudes alimentaires.
Le bio peut-il vraiment se démocratiser ? -Table ronde p. 83 – 87-
Comment faire pour que le bio sorte de la confidentialité ? Un agriculteur biologique, une ancienne députée Vert, le pdg d’une multinationale de l’agroalimentaire et un épidémiologiste travaillant sur les dangers des pesticides ont accepté d’en débattre avec Claude Aubert.
Grégory Fléchet : Dans les années 1990, la filière biologique a pris son essor à la faveur de crises alimentaires à répétition (vache folle, poulet à la dioxine, fromage à la listeria…). À présent que tout semble être rentré dans l’ordre, le développement de la filière biologique connaît un léger ralentissement. Faut-il attendre d’obtenir les preuves indiscutables des méfaits du modèle agricole conventionnel sur notre santé pour que le bio explose enfin ?
Claude Aubert : Quelques personnes, sans doute mieux informées, modifient leurs habitudes de consommation par conviction. Mais la grande majorité de la population ne changera pas son mode d’alimentation s’il n’y a pas urgence pour sa santé. Tant que l’on n’aura pas pu mettre clairement en évidence que le modèle agricole conventionnel a des effets négatifs sur la santé humaine, et je pense que nous sommes désormais en mesure de le faire, l’attitude du consommateur n’évoluera pas. Comme le dit le proverbe : « La peur est le commencement de la sagesse. » Je pense que celui-ci peut s’appliquer aux habitudes alimentaires.
Franck Riboud : Je crois que, dans tous les domaines, la peur fait avancer les choses. Depuis quelque temps, on parle beaucoup de la peur du gendarme. Faisons donc la double hypothèse que l’agriculture classique présente des dangers et que le bio n’en présente pas, même si je ne suis pas convaincu que cela soit entièrement juste. Il ne faut pas confondre faire peur aux gens pour arriver à ses fins et avoir une vraie lecture scientifique des choses. En tant que chef d’entreprise, je dois considérer à fois la législation, le consommateur et la science. Si ces trois éléments ne sont pas en synergie pour l’un de mes produits, je ne le commercialise pas. Aujourd’hui, quand je demande aux scientifiques de me dire si l’agriculture conventionnelle est mauvaise pour la santé – et je ne parle pas des scientifiques qui militent pour l’agriculture biologique –, je n’obtiens pas de réponse claire et forte allant dans ce sens. En ce qui concerne le consommateur, nous sommes constamment à l’affût de ses désirs par l’intermédiaire d’études ou de sondages. Eh bien, aucune étude d’opinion ne nous dit qu’il a peur de l’agriculture classique ou qu’il considère que seul le bio est bon pour sa santé. Il pense surtout que le bio est très cher et que seule une certaine catégorie sociale a les moyens de se le payer. La question est finalement de savoir si je dois effrayer le consommateur dans l’objectif de militer pour le bio. Étant plutôt d’une nature tolérante, je n’en suis pas certain. Il faut surtout instaurer davantage de dialogue entre ces trois catégories que sont le consommateur, le scientifique et le législateur pour que les entreprises de l’agroalimentaire sachent dans quel sens elles doivent aller.
Etienne Gangneron : Je voudrais revenir sur un des aspects de la question qui est le constat, assez préoccupant, de stagnation du développement du bio en France. À partir de 1999, les aides publiques dédiées à cette filière agricole sont pourtant devenues relativement plus importantes que ce qu’elles étaient par le passé. Au début des années 2 000, on a d’abord constaté un certain engouement pour le bio et puis, lorsqu’on a atteint la barre des 2 % de la surface agricole française, le rythme des conversions a commencé à ralentir. La filière laitière de l’agriculture biologique a notamment été montrée du doigt pour avoir mal valorisé sa production. Il faut en effet rappeler que, depuis cette période, près de la moitié du lait certifié biologique se retrouve dans la filière conventionnelle. Cela dit, les grandes cultures céréalières ont suivi la même tendance, avec des prix qui sont descendus au niveau de ceux rencontrés dans la filière conventionnelle, tout comme la viande bovine certifiée AB, qui a connu des hauts et des bas depuis. En fait, il y a un déséquilibre permanent entre le discours du consommateur relayé par les médias, qui consiste à dire que les gens sont de plus en plus attirés par les produits bio, et le développement réel de l’agriculture biologique. J’ai finalement le sentiment qu’en France, on a un peu de mal à analyser la manière dont s’établit cette connexion entre la demande du consommateur et la réaction de la production agricole face à cette demande.
Claude Aubert : Lorsqu’on parle de stagnation de la filière biologique, je crois qu’il faut bien faire la distinction entre production et demande. Certes, la production stagne, mais la demande continue d’augmenter de 10 à 15 % tous les ans. Or, la principale conséquence de ce déséquilibre entre production et demande est que la France qui, il y a quinze ans, était un pays exportateur de produits bio, est désormais obligée d’en importer entre 50 et 60 %.
Etienne Gangneron : Dans notre pays, une grosse partie du développement de la filière bio s’effectue désormais grâce aux produits d’importation, et non pas à partir de la production locale. Cette dernière, qui stagne depuis quelques années, reste intimement liée à la nature du climat. Elle englobe essentiellement le maraîchage, les fruits et les grandes productions que sont le lait, la viande et les céréales.
Luc Multigner : Derrière le bio se posent implicitement les inquiétudes concernant l’impact des pesticides sur la santé. Bien qu’il s’agisse d’une problématique apparue au cours des dernières décennies, la recherche française a, dans ce domaine, pris un peu de retard sur ses voisins européens du fait d’une certaine inertie politique. Pour en revenir à l’unanimité scientifique, dont Franck Riboud parlait à l’instant, il y a un point critique qui est celui de la communication en direction du grand public. Au cours des dernières années, j’ai rarement vu intervenir dans les grands médias français des chercheurs qui travaillent effectivement sur la relation entre pesticides et santé humaine. On a surtout vu s’exprimer des personnes qui possèdent des diplômes académiques mais qui n’ont pas ou qui ont peu publié de travaux scientifiques sur le sujet. Par ailleurs, ces personnes qui s’expriment à la télévision ou dans les journaux adoptent généralement un discours particulièrement négatif, voire catastrophique, vis-à-vis des risques liés aux pesticides. Or, le consommateur se retrouve influencé par le discours de personnalités scientifiques qui n’ont pas toujours la légitimité suffisante pour donner leur avis sur ce genre de problèmes.